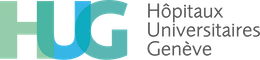Désamour et violences conjugales

Synthèse par Dr E. Escard.
Le désamour, un processus mal connu.
L’amour commence par une rencontre dans laquelle il existe une part de hasard et d’ignorance et nécessite pour continuer du courage et de la ténacité selon le philosophe Alain Badiou. D’après les neuroscientifiques, l’amour passionnel ne dure que quelques années et les statistiques montrent que plus d’une union sur deux se termine par une séparation ou un divorce. Le plaisir d’être ensemble a cédé alors la place au déplaisir, avec parfois l’envoi de signaux opaques à l’autre en fonction de son propre passé (Collectif, 2016).
Parmi les facteurs de risque connus aux violences conjugales, il y a l’insatisfaction ou la mésentente conjugale et plus précisément dans la période proche d’une séparation ou après son annonce. Parmi les causes possibles d’une séparation, il y a le désamour qui est souvent unilatéral (ou asymétrique) au départ. Celui-ci est d’ordinaire vécu comme un traumatisme par l’autre qui le subit, mais aussi celle ou celui qui le ressent, vit ce changement de l’intérieur. Nous pouvons donc nous poser la question de pourquoi et comment ce processus fréquent de décomposition amoureuse amène un tel stress et que peut-il être fait pour prévenir ce stress qui peut faire apparaître ou aggraver des violences ?
Le désamour se définit comme la perte, la cessation ou la diminution de l’amour ou de l’intérêt pour quelqu’un ou quelque chose. Autant il y a beaucoup d’écrits sur l’amour, il y en a très peu sur le désamour qui se prête peu au jeu de l’idéalisation, l’amour étant du côté du positif et de la vie. Le désamour est en général une expérience dont on n’a pas envie de parler, de faire le récit, parfois mystérieuse. Il semble procéder d’un délitement, d’un sentiment de vide et de désillusion, et on ne le comprend pas toujours sur le moment même s’il y a des signes avant-coureurs qu’on ne voit pas ou ne veut pas voir. Le sujet perd la maîtrise de son destin, il y a une forme profonde de dépossession, de fracture. Le désamour est une expérience émotionnelle qui va faire crise. La rupture qui peut suivre est souvent une expérience tragique, une épreuve de vie. Il faut faire le deuil d’un attachement, d’une histoire, d’un horizon dans lequel on se projetait.
Selon Brugère F (2024), désaimer serait se réapproprier la dépossession, la faire sienne, l’assumer, la prendre en charge. C’est un chemin à la fois existentiel et éthique, une expérience transformatrice. Le sujet apprend à faire avec une capacité intérieure, redécouvre un rapport à soi. Le désamour peut amener à créer de nouveaux liens, favoriser dans ce sens une libération, une émancipation.
Cela implique un art de désaimer qu’on ne nous a jamais enseigné, alors que les relations humaines sont par nature fragiles et instables et que le désamour est un processus peu rationnel.
Se remettre d’une séparation reste souvent difficile pour celui ou celle qui n’en a pas pris l’initiative. Nous avons une vision fixe et rigide des relations amoureuses qui laissent peu de place au dynamisme et à l’évolution asymétrique des relations. Les grands modèles dominants idéalisés sont celui de la fusion amoureuse ou du grand partage égalitaire ou de la complémentarité des différences, modèles qui peuvent se jouer de nous et faire illusion. Cette idéalisation peut empoisonner la relation en l’enfermant dans un cadre rigide.
Cette expérience est avant tout une expérience de l’être fini avec la peur de la fin d’une relation supposée éternelle comme dit dans le serment du mariage en privilégiant la stabilité quoi qu’il en coûte, quitte à se mentir à soi-même et aux autres… L’amour donne de la joie et un sens immédiat (voire divin) à la vie, ce qui va rendre la séparation d’autant plus douloureuse.
Rôle des thérapeutes avant ou après le désamour?
Le désamour n’est heureusement pas une fatalité au sein des couples, certains mécanismes destructeurs du couple qui finissent par ruiner l’amour peuvent être pris en charge précocement avant qu’il ne soit trop tard. Une conversation honnête ouverte sur ce désamour débutant ou avancé est nécessaire, il faut voir si des efforts sont possibles pour revitaliser une relation en souffrance. Une thérapie individuelle voire de couple peut être utile, en promouvant plus de sécurité et d’autonomie, ou en travaillant sur un nouveau rapport au monde en lien avec ce désamour.
Dans une relation, certains signes peuvent être liés à un désamour d’un côté ou des deux côtés, comme par exemple la diminution du dialogue et du partage, des disputes fréquentes, le détachement, le silence, l’évitement de l’autre (y compris au niveau physique) à qui on ne trouve que des défauts et qui devient un ennemi, l’ennui ensemble, la disparition des plans communs. Les premiers signes peuvent être l’agacement, la rengaine, les interprétations erronées sur l’autre (Thalmann Y-A, 2014). La répétition de ces schémas peut amener à des violences notamment verbales et psychologiques.
Le désamour ne se commande pas et nécessite une adaptation du couple qui peut aller jusqu’à la séparation. Ce risque de départ d’un membre du couple peut mettre à mal tout le fonctionnement des partenaires, du couple et de la famille. Au niveau individuel, cela peut être source d’anxiété, de dépression, aggraver des problèmes de dépendance etc.
Se préparer au désamour, permet de voir l’amour autrement, avec des attentes différentes, en modifiant nos imaginaires, les stéréotypes qui sclérosent les relations amoureuses, y compris des mécanismes de domination. Le désamour ne doit pas être considéré comme un échec (Brugère F).
Le désamour va particulièrement poser problème avec un risque de violences dans les couples où il y a une grande dépendance ou rigidité, avec des personnalités vulnérables à l’abandon, à la critique, à la « trahison ». Le ou la partenaire qui continue à aimer peut rapidement se placer en victime de ce changement, faire des accusations, reproches, pressions, du chantage vis-à-vis des enfants etc. Ceci sera d’autant plus probable si elle ou il présente des troubles mentaux invalidants. L’amour peut devenir une « drogue dure » lorsqu’il y a plus de souffrance que de bonheur, et que les « victimes » n’arrivent pas à mettre fin à une relation toxique et destructive en niant par exemple la violence de l’autre ou ses importants défauts. Le traitement devra intégrer la prise en charge d’une dépendance relationnelle pathologique et les comorbidités qui la favorisent (Versaevel C, 2012).
Une prévention de la désillusion amoureuse?
Les ruptures amoureuses sont de plus en plus nombreuses aujourd’hui et il est donc nécessaire d’apprendre à désaimer sans être dans le déni, alors que le sujet est encore un tabou. Pendant longtemps, on restait ensemble en couple malgré la disparition des sentiments et il faut noter que dans certaines cultures l’amour n’est pas le ciment du couple comme chez nous et le problème ne se pose même pas. La séparation n’est pas qu’une affaire privée (comme les violences conjugales), elle est connectée au monde par ses impacts et il est important de ne pas gommer les expériences négatives du discours social. Dans la prévention du désamour traumatique, il y a aussi le fait d’être moins dans les stéréotypes, de considérer l’amour autrement pour aimer mieux. L’attachement est aussi à penser avec le détachement, et il est particulier qu’on ne nous ait rien appris sur ce sujet important dans notre éducation (ni à l’école, ni par nos parents…). Arriver à désaimer, c’est aussi reconstruire une estime de soi et désinvestir son désir du sujet aimé comme dans un deuil à prendre comme une épreuve de vie et non un échec où l’autre doit être critiqué, méprisé, jeté.
Cependant, comme le dit l’écrivain François Solesmes dans l’Amour le désamour (2007), « mieux vaut souffrir d’avoir aimé que souffrir de ne pas avoir aimé »…
Pour en savoir plus :
Brugère F. Désaimer. Manuel d’un retour à la vie. Flammarion, 2024.
Collectif. L’Amour, un besoin vital. Editions Sciences humaines, 2016.
Thalmann Y-A. Garder intact le plaisir d’être ensemble. Prévenir le désamour. Jouvence Editions, 2014.
Versaevel C. Personnalité dépendante et dépendance affective : stratégies psychothérapeutiques. L’Encéphale 2012, 38:170-178.