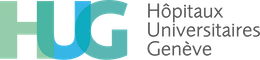Pratiques cliniques à l’épreuve des risques criminels : entre prévention de la récidive violente et accompagnement du processus de désistance

Auteur : Floriano von Arx, psychologue-psychothérapeute
L’intervention auprès des personnes placées sous main de justice requiert aujourd’hui une double exigence : évaluer rigoureusement les risques tout en soutenant les processus de changement. Si ces deux volets relèvent de logiques complémentaires, ils ne se confondent pas. L’évaluation cherche à anticiper la probabilité de récidive violente (actes de violences, de délinquance, actes criminels…) et à guider la répartition des ressources, tandis que la prise en charge s’inscrit dans le temps long du changement et de la reconstruction moyennant l’allocation des ressources nécessaires à ce processus communément appelé « désistanciel ».
L’évaluation structurée du risque : une exigence de rigueur
L’évaluation du risque criminel repose sur une méthodologie structurée, s’appuyant sur des outils validés scientifiquement, une triangulation des sources (dossiers, entretiens, observations) et une analyse contextualisée des éléments disponibles. Loin d’un jugement subjectif ou d’une impression clinique isolée, elle vise à objectiver les facteurs liés à la récidive potentielle tout en intégrant la complexité des parcours individuels.
Le modèle RBR (Risque – Besoins – Réceptivité) est aujourd’hui la référence dominante dans ce domaine. Il articule trois principes :
- Le principe de risque commande une intensité d’intervention proportionnelle à la probabilité de récidive : les personnes à haut risque nécessitent un accompagnement plus soutenu, tandis qu’une intervention trop intensive chez les profils à faible risque peut même s’avérer contre-productive.
- Le principe de besoins cible prioritairement les besoins criminogènes, c’est-à-dire les facteurs dynamiques en lien avec les comportements délinquants (consommation de substances, fréquentations, attitudes procriminelles et/ou antisociales, difficultés dans les relations familiales et professionnelles, défaut d’insertion socio-économique et sociale).
- Le principe de réceptivité implique une adaptation des méthodes d’intervention aux caractéristiques individuelles : capacités cognitives, style d’apprentissage, culture, vécu psychologique.
Des outils spécifiques permettent une combinaison de données statiques et actuarielles (passé judiciaire, antécédents) et dynamiques (facteurs actuels, évolutifs). Ce processus structuré permet d’informer les décisions judiciaires et les choix d’orientation, tout en limitant les biais subjectifs.
Prendre en charge : accompagner le changement, soutenir la désistance
L’intervention ne peut toutefois se réduire à la gestion du risque. Elle s’inscrit dans la perspective de la désistance, entendue comme le processus par lequel une personne s’éloigne durablement des conduites délinquantes. Ce processus est non linéaire, souvent jalonné de rechutes, de prises de conscience progressives et de réélaborations identitaires. Les postures professionnelles doivent intégrer la capacité à envisager le potentiel de la personne traitée à développer des conduites plus adaptées et en lien avec la réalité, sans se limiter à une focalisation sur son identification aux délits commis, afin d’éviter de la figer dans une identité délinquante.
Les dimensions de la désistance sont multiples :
- Cognitives : modification de la perception de soi, du rapport à la loi et à la responsabilité.
- Affectives : capacité à réguler ses émotions, à faire face aux frustrations ou aux échecs.
- Narratives : élaboration d’un récit de vie où l’identité délinquante ne constitue plus le noyau central.
- Sociales : reconstruction de liens prosociaux, intégration dans des réseaux de soutien.
- Structurelles : accès effectif à un logement, à une activité stable, à des soins adaptés.
Ce cheminement demande un accompagnement professionnel fondé sur la reconnaissance, la rigueur et la patience. Il repose également sur une relation de confiance, dans laquelle les intervenants incarnent une exigence bienveillante et crédible, ce qui exige une « prise de risque responsable » à ce que des changements positifs soient promus.
S’agissant de l’apport médical et psychologique, notre domaine de compétences, il convient d’en reconnaître à la fois l’importance et les limites. En effet, d’autres champs d’intervention – social, structurel, relationnel – doivent également être mobilisés afin de répondre de manière concrète aux besoins fondamentaux des personnes accompagnées. Cette approche permet d’éviter de conférer un rôle central et exclusif aux suivis médico-psychologiques dans la prévention du risque de récidive.
Des champs criminels différenciés, des approches spécifiques
L’approche ne peut être uniforme : les types de délinquance appellent des analyses différenciées, en lien avec leurs déterminants spécifiques.
- Les infractions sexuelles appellent une attention particulière à la gestion du secret, des distorsions cognitives et de la culpabilité. Il est essentiel de ne pas confondre fantasmes et passages à l’acte, ni de surestimer ou sous-estimer les risques sans fondement clinique.
- La radicalisation violente mobilise des outils spécifiques, et nécessite une compréhension des ruptures biographiques, de l’adhésion idéologique et des mécanismes de groupe.
- La violence intrafamiliale, notamment conjugale, implique une lecture relationnelle et contextuelle, souvent marquée par les rapports de domination, les cycles de contrôle et la récurrence des schémas affectifs, ainsi que les dimensions psychotraumatiques infiltrant l’organisation relationnelle de couple et familiale.
- La criminalité en col blanc (fraude, détournement, abus de biens sociaux) engage des processus de justification morale, un usage stratégique des normes et un positionnement social particulier qui demandent une approche différente.
- La primo-délinquance, souvent juvénile, exige une lecture développementale et une action rapide sur les facteurs de protection (scolarité, encadrement, pairs prosociaux).
Chaque domaine a ses logiques propres, ses biais d’évaluation possibles et ses marges d’action spécifiques. Adapter les outils et les démarches est donc essentiel pour éviter les erreurs de catégorisation ou les interventions inappropriées.
Conditions d’efficacité : posture, coordination, cadre éthique
La qualité des interventions dépend de plusieurs facteurs :
- Une formation approfondie et continue des professionnels à la fois sur les outils et les modèles, mais aussi sur les enjeux éthiques et relationnels.
- Une coordination interdisciplinaire efficace, associant magistrats, agents de probation, psychologues, éducateurs, psychiatres, travailleurs sociaux et structures communautaires.
- Un recueil d’information rigoureux, qui croise les sources, vérifie les hypothèses et contextualise les éléments disponibles.
Cette approche suppose aussi une vigilance éthique constante. Travailler avec des personnes ayant commis des actes violents n’efface en rien la souffrance des victimes, ni l’impératif de protection. Mais la prévention durable des violences passe par une action cohérente, capable de combiner fermeté et espoir, exigence et soutien, au-delà de toute position idéologique ou morale pouvant faire barrage à un accompagnement efficace.
Conclusion : sécurité, changement et responsabilité partagée
Évaluer les risques et accompagner la désistance ne sont pas deux logiques concurrentes, mais deux dimensions d’un même engagement professionnel. L’une garantit la protection des victimes et de la société ; l’autre soutient une transformation durable, qui ne nie ni la faute ni la gravité des actes, mais ouvre un chemin de reconstruction.
Investir dans des dispositifs rigoureux, humains et différenciés permet de dépasser les réponses mécaniques ou purement répressives. En tenant ensemble la lucidité du diagnostic et la confiance dans la capacité de changement, on agit de manière responsable, au service à la fois de la sécurité collective et de la dignité humaine.
Bibliographie
Andrews, D.A. & Bonta, J. (2015). Le comportement délinquant. Analyse et modalités d’intervention (5e éd.). Paris : Les Presses de l’ENAP.
Benbouriche, M., Vanderstukken, O. & Guay, J.-P. (2015). Les principes d’une prévention de la récidive efficace : le modèle Risque-Besoins-Réceptivité.
Pratiques psychologiques, 21(3), 219–234. Guay, J.-P., Benbouriche, M. & Parent, G. (2015). L’évaluation structurée du risque de récidive des personnes placées sous main de justice : méthodes et enjeux.
Pratiques psychologiques, 21(3), 235–257. Côté, G. (2001). Les instruments d’évaluation du risque de comportements violents : mise en perspective critique.
Criminologie, 34(1), 31–45. Gautron, V. & Dubourg, E. (2015). La rationalisation des outils et méthodes d’évaluation : de l’approche clinique au jugement actuariel.
Cet article constitue une synthèse personnelle réalisée à la suite de la formation continue « Évaluer et gérer les risques criminels : principes, méthodes et pratiques », organisée à Lausanne dans le cadre du programme de l’Université de Lausanne – UNIL Formation Continue (https://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/evaluer-gerer-risques-criminels).
Il reflète le point de vue de l’auteur de l’article, ainsi que sa compréhension et ses choix d’interprétation des contenus abordés durant la formation. Il ne prétend ni représenter l’ensemble des apports, ni la position officielle des intervenant·e·s ou des organisateurs.