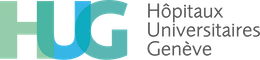Highlight- Le harcèlement dans les espaces « publics »
Synthèse : Dr E. Escard.
Un article français récent fait le point sur le harcèlement dans les espaces « publics », et les similitudes notamment entre le harcèlement de rue et celui qui peut se passer au travail, durant les études ou dans des groupes sportifs dont les femmes, les minorités et les personnes en situation de handicap font le plus les frais. Le harcèlement sexuel n’est également jamais très loin dans ces situations.
Le harcèlement se décrit par des comportements intentionnels agressifs qui se répètent dans le temps et qui visent à affaiblir, à nuire à la victime, ou à obtenir d’elle un acte imposé. Il est très fréquent dans l’espace en dehors du couple et de la famille. Cela concerne les espaces relatifs aux interactions sociales, comme les rues et transports en commun, le voisinage, les bars, commerces, salles de sport, les lieux de loisirs, les services administratifs etc.
Autant le harcèlement au travail est plutôt bien décrit et circonscrit, ce n’est pas le cas du harcèlement de « rue ». Celui-ci peut comprendre des comportements verbaux inappropriés (sifflements, remarques), des regards insistants, des comportements physiques agressifs avec un suivi, rapprochement, saisissement, des attouchements non désirés. Les femmes en sont beaucoup plus victimes, et par des hommes. Ces sollicitations peuvent viser à amorcer une relation pour aboutir à des avantages sexuels, cet harcèlement portant essentiellement sur l’apparence physique des femmes avec une connotation sexuelle évidente. Dans certains cas, il peut être aussi associé à l’occupation d’un territoire, à l’exclusion d’une personne différente dans ses caractéristiques (en fonction de son orientation sexuelle, de sa religion, de son origine sociale ou culturelle).
Pour le harcèlement sexiste de rue, les études montrent qu’il ne se produit pas si les femmes sont accompagnées par un homme et qu’ils sont plus fréquents dans les pays où les comportements d’hostilité des hommes envers les femmes sont plus importants, dans les espaces genrés masculins (par exemple stade, bas des immeubles, bar…). Des enquêtes récentes en Europe montrent que 50 à 70 % des femmes auraient subi ce type de harcèlement au cours de leur vie, avec une tolérance sociale par rapport à ses faits, une sous-déclaration et un évitement intériorisé des femmes de certaines zones à risque. Ces chiffres sont semblables pour les femmes qui disent avoir subi du harcèlement sexuel notamment au cours de leurs études…
Ces différents types de harcèlement comportent de nombreuses similitudes malgré les différents cadres institutionnels et sociétaux dans lesquels elles s’exercent. Les conséquences sur la santé globale sont importantes.
En ce qui concerne les conséquences sociales, ces harcèlements augmentent le sentiment d’insécurité, et les victimes vont développer des stratégies d’évitement à tous les niveaux, par exemple en ne prenant plus les transports en commun, en évitant certains quartiers, certaines salles de sport ou certains spectacles. Au niveau professionnel, cela peut aboutir à une réorientation par rapport aux études ou un changement de travail avec moins d’employés masculins. En clinique, nous avons déjà eu le cas pour certaines femmes travaillant par exemple dans le bâtiment, un garage, comme conductrice de camion ou agente de sécurité et qui doivent changer de filière.
Ces femmes peuvent vivre un véritable sentiment de continuité entre les espaces publics et privés, du domicile au travail et durant les trajets dans l’espace urbain et pour leurs activités de loisir ou administratives. Ces harcèlements ne comportent pas forcément de relations coercitives mais impactent fortement la vie d’une bonne partie de la population.
Dans le domaine du sport et du harcèlement de rue, il y a peu de recherches pour analyser le phénomène. Se pose la question de comment repenser et modifier l’organisation et l’aménagement des espaces urbains en parallèle à des actions de prévention des violences sexistes et sexuelles et des violences par les jeunes notamment les plus défavorisés et ses enjeux identitaires.
Courtois R et al. Reconnaître et gérer les conséquences du harcèlement dans l’espace « public ». Annales médico-psychologiques 2024, 182:683-684.