Violence vicariante : une forme spécifique de violence psychologique indirecte à reconnaître d’urgence

Par Alice Delmenico, criminologue, victimologue.
En matière de violences intrafamiliales, certains mécanismes restent encore largement invisibilisés bien qu’ils causent des dommages psychiques majeurs. C’est le cas des violences psychologiques indirectes et en particulier de la violence vicariante, une forme pouvant être extrême de maltraitance émotionnelle post-séparation exercée à travers les enfants. Conceptualisée en Espagne depuis une décennie, cette forme de violence de genre reste absente du droit francophone, alors même qu’elle constitue une menace majeure pour les mères et les enfants concernés. Cet article vise à en définir les contours, à éclairer les stratégies sous-jacentes et à interroger les enjeux de reconnaissance et d’intervention.
Comprendre les violences psychologiques indirectes
Les violences psychologiques indirectes englobent toutes les stratégies de contrôle, de manipulation ou d’atteinte psychique qui ne passent pas par une agression frontale, mais par des moyens implicites détournés, souvent insidieux et difficilement détectables par l’entourage ou les institutions. Contrairement aux violences explicites, ces actes ne s’expriment pas directement à l’encontre de la victime, mais s’opèrent à l’aide d’intermédiaires, qu’ils soient humains (enfants, proches, professionnels) ou symboliques (objets, silences, comparaisons, inégalités de traitement, menaces). Ces violences, souvent invisibles pour l’entourage ou les institutions, sont pourtant dévastatrices.
Elles se manifestent notamment par des :
- Dénigrements systématiques auprès des enfants, de l’entourage, du voisinage, des collègues de travail, des institutions et professionnels,
- Diffamations, manipulations, mensonges et fausses accusations en se faisant passer pour la victime auprès du cercle privé, professionnel et du réseau des intervenants dans les domaines du judiciaire, médical et social,
- Pressions exercées par des tiers (amis, famille, institutions),
- Menaces symboliques verbales « ça serait dommage qu’il t’arrive quelque chose… » et intimidation à l’aide d’objets (l’auteur·e se tient à proximité d’un couteau ou autre objet dangereux),
- Stratégies d’isolement ou de harcèlement social indirect à la suite de diffamations ou fausses rumeurs auprès des groupes d’amis,
- Comparaisons dévalorisantes ou traitements différenciés,
- Instrumentalisation des enfants ou de l’environnement proche pour nuire à la victime.
Au cœur de ces dynamiques se trouve une violence particulièrement perverse et destructrice ; la violence vicariante.
La violence vicariante : frapper là où cela fait le plus mal
La violence vicariante (étymologie : « qui remplace quelque chose d’autre ») a été conceptualisée en 2012 en Espagne par Sonia Vaccaro, psychologue clinicienne, experte judiciaire et spécialiste en victimologie et en violence fondée sur le genre. Cette conceptualisation théorique fait suite à un drame survenu en 2011, qui avait profondément bouleversé le pays : le meurtre de deux enfants mineurs par leur père, commis dans le seul but d’infliger à la mère une souffrance extrême, irréparable et éternelle (Vaccaro, 2023a, 2023b ; Amnesty International Espagne, s.d.).
La violence vicariante est une violence machiste post-séparation qui s’inscrit dans une dynamique genrée patriarcale dont le but est de chercher à atteindre, punir ou contrôler la mère à travers un tiers soit les enfants issus de l’union commune ou d’une précédente union pour « frapper là où ça fait le plus mal » (Vaccaro, 2023b).
Pour ce faire, le père (ou l’ex-compagnon actuel) va déployer plusieurs stratégies de violences psychologiques indirectes à la mère impliquant de la maltraitance directe sur les enfants :
- Menacer d’enlever les enfants, de retirer la garde ou de les tuer,
- Exploiter la présence des fils et filles pour insulter la mère, parler mal d’elle, l’humilier et la menacer,
- Instrumentaliser les enfants (« syndrome d’aliénation parentale »),
- Interrompre ou refuser les consultations et les traitements médicaux ou médicamenteux des enfants lorsqu’ils devraient être pris en charge,
- Utiliser les moments de droit de visite pour inventer des informations douloureuses au sujet des enfants, ou pour priver la mère d’informations pendant ces périodes,
- Discréditer les capacités parentales de la mère et la diffamer aux différentes instances ainsi que multiplier les procédures administratives et légales dans une volonté de harcèlement,
- Tuer les enfants afin de provoquer une détresse émotionnelle irréversible à la mère.
La notion d’utilisation de tiers étant centrale dans la violence vicariante, celle-ci s’étend également à la manipulation des personnes proches ou chères de la victime, à la destruction de tout objet (photographie, vaisselle d’héritage,…) ayant une valeur sentimentale ainsi qu’à la maltraitance voire la mort de l’animal de compagnie. La diffamation de la mère auprès des instances juridiques mais également de ses proches, sa famille ou de ses collègues et de son supérieur hiérarchique fait également partie des pratiques courantes de violences psychologiques indirectes définies comme vicariantes.
Les enfants, en chiffre : victimes directes d’une violence dirigée contre leur mère
Ainsi, la violence vicariante revêt une immense cruauté du fait que son auteur agit sciemment dans la volonté de nuire de manière indirecte à sa victime principale, la mère, par l’intermédiaire des enfants, victimes directes. Ces derniers pouvant être instrumentalisés jusqu’à la provocation de leur mort (Vaccaro, 2023a).
Selon le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, en 2024, 9 enfants (5 filles et 4 garçons, âge moyen : 6,2 ans) ont été assassinés en Espagne par 6 agresseurs, dont 7 victimes étaient les enfants biologiques. Ces crimes, relevant de la violence vicariante portent à 62 le nombre total de mineurs tués depuis 2013, soit une moyenne annuelle de 5,2 cas. 74,2 % des victimes depuis 2013 avaient moins de 10 ans, et 5 des enfants tués en 2024 étaient espagnols, comme dans 74,2 % des cas sur l’ensemble de la période.
Dans 4 cas, l’enfant vivait avec son meurtrier. 7 des 9 meurtres ont eu lieu au domicile partagé. En 2024, les méthodes utilisées incluaient l’asphyxie, l’empoisonnement, les coups et les armes à feu, tandis que l’arme blanche reste historiquement la plus courante (35 %).
Parmi les agresseurs, 4 étaient espagnols, 2 se sont suicidés, et 5 avaient été dénoncés auparavant par leur (ex-)partenaire — soit 83 % en 2024, contre 35,4 % historiquement, et 26 % dans les cas de féminicides.
Profil des auteurs et des victimes de violences vicariantes : entre invisibilité, antécédents ignorés et extrême préméditation
Les données issues des cas espagnols recensés entre 2010 et 2022 révèlent un profil particulièrement alarmant des auteurs de violences vicariantes. Dans 82 % des cas, l’auteur est le père biologique de l’enfant tué ou gravement blessé, et 52 % sont séparés ou divorcés de la mère au moment des faits. Si 74 % des auteurs sont déjà identifiés comme auteurs de violences conjugales, seules 46 % des femmes ont pu déposer une plainte avant le passage à l’acte, souvent en raison de l’isolement, de la peur ou d’un manque de protection institutionnelle (Observatoire de la violence, 2022).
Environ 26 % des auteurs présentent des antécédents judiciaires connus, dont la majorité pour des faits de violences machiste. Certains agresseurs souffrent de troubles mentaux, comme le montre un cas emblématique survenu à Murcie en 2025, mais la majorité ne relèvent d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée (Chaîne SER, 2025 ; Université Complutense de Madrid, 2023). Selon l’experte Sonia Vaccaro, les agresseurs considèrent les enfants comme des objets ou des moyens de vengeance contre la mère, plutôt que comme des individus à protéger.
Du côté des victimes, les données espagnoles les plus récentes indiquent qu’au moins 62 enfants ont été tués dans un contexte de violence vicariante entre 2010 et 2023, dont 7 enfants en 2021, 6 en 2022 et 4 en 2023 (Ministère de l’Égalité, 2024). Ces meurtres s’inscrivent dans une dynamique de représailles visant à atteindre la mère : les enfants sont utilisés comme instruments de destruction psychologique. Dans tous les cas recensés, la mère est la cible indirecte de la violence. L’absence de dispositifs de protection adéquats, en particulier en contexte de séparation conflictuelle, apparaît dès lors comme un facteur aggravant majeur.
Entre invisibilisation, confusion conceptuelle et disparités juridiques internationales
Le terme de violence vicariante n’est pas reconnue en droit suisse ni français, et son usage reste inexistant dans les textes juridiques et les statistiques. En France, les infanticides liés à des conflits conjugaux sont par exemple classés sous la catégorie vague de « conflits de couple sans homicide conjugal », comme en témoignent les 22 cas d’infanticides sans meurtre parental relevés en 2019 (Desfarges, 2022).
Quant à la Suisse, le Code pénal traite encore les infanticides dans le cadre de l’homicide intentionnel (art. 111), sans spécificité en cas de violences genrées post-séparation. Le silence juridique est de fait lourd de conséquences ; absence de protection adaptée, difficulté à qualifier les faits, invisibilisation des victimes, impunité des auteurs (Desfarges, 2022).
À cette invisibilisation s’ajoute une confusion fréquente avec le traumatisme vicariant, qui concerne les professionnels exposés aux violences, et non les victimes de violences indirectes elles-mêmes.
Toutefois, certains pays ont commencé à reconnaître explicitement la violence vicariante dans leurs législations : l’Espagne fait figure de pionnière en Europe, en intégrant cette notion dans la loi en 2021, et en reconnaissant les enfants comme victimes directes de violences de genre. Hors d’Europe, le Mexique l’a également récemment inscrite en 2023 dans sa loi fédérale sur les violences faites aux femmes, tandis que l’Argentine et l’Équateur, bien que n’ayant pas encore adopté de cadre juridique spécifique, voient émerger des débats publics et institutionnels sur le sujet. A noter que le Mexique enregistre l’un des taux les plus élevés de violence machiste dont les féminicides et que sa politique gouvernementale vise depuis plusieurs années à combattre ces violences pour lesquelles le 97% des crimes demeurent impunis (Paget, 2022).
Ces disparités soulignent l’urgence d’une reconnaissance internationale de la violence vicariante pour garantir une protection effective aux victimes et une qualification adéquate des faits.
L’exemple espagnol : une reconnaissance juridique pionnière
L’Espagne est le premier pays à reconnaître juridiquement la violence vicariante depuis 2021. Celle-ci est définie comme délit dans la Loi organique 8/2021 sur la protection intégrale des enfants et adolescents contre la violence, et intégrée dans la Loi 1/2004 contre la violence de genre. Dès 2017, elle était déjà mentionnée dans le Pacte d’État contre la violence de genre (Gouvernement d’Espagne, 2021).
Ce cadre permet :
- de nommer et d’identifier la violence,
- d’établir des outils de détection et d’évaluation du risque,
- de garantir une prise en charge médicale et psychologique dès l’âge de 16 ans,
- et de mettre en place des politiques de prévention spécifiques.
Comme le souligne la sociologue spécialisée dans la violence de genre Carmen Ruiz Repullo :
« La violence vicariante, c’est la violence qui s’exerce sur les enfants des femmes victimes quand l’agresseur n’a plus de prise sur la vie de la victime. Il a compris qu’il pouvait continuer à lui faire du mal à travers ses enfants. En lui donnant un nom, on commence à identifier les cas. Quand il n’y a pas de nom pour désigner une situation, bien souvent, ça atténue sa portée et on ne met pas en place les outils pour l’éradiquer » (Ruiz Repullo, 2021, cité dans AFP, 2021).
Vers une reconnaissance francophone de la violence vicariante ?
La reconnaissance de la violence vicariante dans l’espace francophone reste un chantier majeur. Il est essentiel de sortir de l’invisibilité pour pouvoir intervenir. Nommer cette violence, c’est reconnaître ses victimes, donner des outils aux professionnel·les, adapter les lois et surtout, protéger les enfants.
L’urgence n’est pas seulement légale : elle est humaine, sociale, clinique et politique. Il est temps que les systèmes de protection de l’enfance, de la justice familiale et des politiques publiques intègrent cette réalité destructrice. La lutte contre les violences de genre ne pourra être complète sans elle.
Références
AFP. (2021). Carmen Ruiz Repullo sur la reconnaissance de la violence vicariante. Cité dans Amnesty International Espagne (s.d.).
Amnesty International Espagne. (s.d.). Qu’est-ce que la violence vicariante ? https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/que-es-la-violencia-vicaria/
Cadena SER. (2025, 2 mai). Decretan el ingreso en prisión en el módulo psiquiátrico el acusado de matar a su suegra y herir a su pareja en Sangonera la Seca. https://cadenaser.com/murcia/2025/05/02/decretan-el-ingreso-en-prision-en-el-modulo-psiquiatrico-el-acusado-de-matar-a-su-suegra-y-herir-a-su-pareja-en-sangonera-la-seca-radio-murcia/
Cadena SER. (2025, 2 avril). Una experta en violencia vicaria: “Los niños son solo un objeto para los asesinos”. https://cadenaser.com/nacional/2025/04/02/una-experta-en-violencia-vicaria-los-ninos-son-solo-un-objeto-para-los-asesinos-cadena-ser/
Conseil Général du Pouvoir Judiciaire. (2025, 5 mai). La violence de genre dans le cadre du couple ou de l’ex-partenaire a causé la mort d’une femme tous les 7,6 jours en 2024. https://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/Panorama/La-violencia-de-genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-expareja-causo-la-muerte-de-una-mujer-cada-7-6-dias-durante-2024
Desfarges, J. (2022, 17 février). Violences conjugales : faut-il suivre le modèle espagnol ? Actu-Juridique. https://www.actu-juridique.fr/international/droit-compare/violences-conjugales-faut-il-suivre-le-modele-espagnol/
Gouvernement d’Espagne. (2021). Loi organique 8/2021 du 4 juin sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence face à la violence. Boletín Oficial del Estado, nº 134. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-9347
Ministère de l’égalité. (2024). Statistiques contre la violence vicariante 2010–2023. Gobierno de España. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaVicaria/estadisticas/
Observatoire de Violence. (2022). Première étude sur la violence vicariante en Espagne. Fundación Mujeres. https://observatorioviolencia.org/se-publica-el-primer-estudio-sobre-violencia-vicaria-en-espana/
Paget, C. (2022, 28 juillet). Féminicides au Mexique : 97 % de ces crimes ne sont jamais éclaircis. Radio France Internationale. https://www.rfi.fr/fr/amériques/20220728-féminicides-au-mexique-97-de-ces-crimes-ne-sont-jamais-éclaircis
Université Complutense de Madrid. (s.d.). Violence vicariante : la pire des maltraitances [Podcast]. UnivPodcast. https://www.ucm.es/univpodcast/violencia-vicaria-el-peor-de-los-maltratos
Vaccaro, S. (2023a). Violence vicariante : une forme extrême de violence de genre [Podcast]. Dans La Tercera. Spotify. https://open.spotify.com/episode/283H2Hm6QrNRCcA6KrtDei
Vaccaro, S. (2023b). Violence vicariante : frapper là où cela fait le plus mal. Bilbao : Desclée De Brouwer.
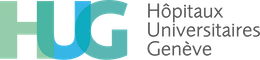

Bonjour. Le résumé venant de facebook évoque bien ex conjoint(e) donc parallèle père ou mère. MAIS encore une fois dès 1er paragraphe de l’article ce sont les pères hommes visaient !
En accord complet avec Alexis, cette violence psychologique est loin d’être uniquement masculine. Cette forme de vengeance est très largement partagée par l’un ou l’autre des parents indépendamment de leur sexe. De nombreux pères ont été insidieusement éloignés de leurs enfants après une séparation… Là-aussi au détriment d’enfants facilement manipulables… Dont la majorité, quand il s’agit du père qui est « l’éloigné » ne cherchera que rarement la vérité plus tard…